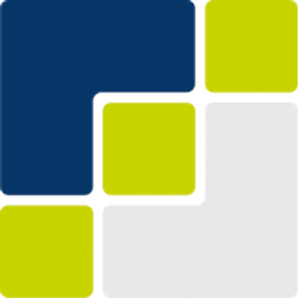L’objectif de cet exposé est l’étude d’une équation de diffusion non linéaire fractionnaire posée sur un domaine bornée. Cette équation constitue une variante de l’équation des milieux poreux ou de l’équation de diffusion rapide, dans laquelle le laplacien est remplacé par un laplacien fractionnaire. Dans le cas des milieux poreux, les solutions présentent une décroissance à vitesse algébrique, tandis que dans le cas de la diffusion rapide, elles présentent un phénomène d’extinction en temps fini: à partir d’un certain temps elles sont uniformément nulles. Par ailleurs, les solutions convergent vers les solutions à variables séparées, lorsque le temps tend vers l’infini dans le cas des milieux poreux, ou lorsqu’il tend vers le temps d’extinction dans le cas de la diffusion rapide. Nous introduirons ensuite un schéma numérique qui préserve ces propriétés qualitatives. Ce schéma permettra de déterminer numériquement le temps d’extinction ainsi que le taux de convergence vers les solutions à variables séparées.